„Chaque jour un enfant rit en moyenne trois cents fois alors qu’un adulte pas plus de cinq ou six fois“ – c’est là une des statistiques qui essaiment les essais de Marica, l’un des trois personnages principaux de „Toutes les personnes“ de Raphaël Meltz, qui raconte l’histoire de deux humoristes et d’une chercheuse sur l’humour et la folie qui, passionnée par son sujet de recherche, tombera aussi amoureuse de ces deux humoristes, dont un mènera une vie lestée par la dépression.
En littérature, dont on associe pourtant bien souvent le pouvoir imaginatif et le côté ludique aux années si rieuses de nos enfances, on tend cependant à sous-estimer le rôle de l’humour. Un livre drôle, ça ne peut pas être bien sérieux, ça ne doit donc servir qu’au divertissement, comme ces comédies romantiques qu’on passe à la télé, qui bien souvent ne font même pas rire et qui sont de purs produits mercantiles, destinés à nous divertir – au sens pascalien du terme – de notre condition de ressources humaines soumises au rythme de production de plus en plus effréné de la folie néolibérale.
D’ailleurs, alors que l’on parle de diversité et que même en France, pays dont le milieu littéraire est machiste, patriarcal et centraliste à souhait, l’on daigne enfin et à juste titre récompenser de plus en plus souvent des écrivaines et des écrivain·e·s francophones, il est presque inimaginable qu’un roman drôle soit un jour couronné par le prix Goncourt.
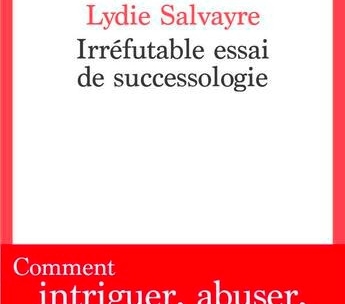
Réhabiliter l’humour
Car même des auteurs a priori comme Jean Echenoz ou Lydie Salvayre, à la lecture desquels on rigole généralement souvent et beaucoup ont été couronnés par le prestigieux prix littéraire pour leurs romans les moins drôles.
Ainsi, „Pas pleurer“, le roman goncourisé de Lydie Salvayre, évoque la guerre d’Espagne et les relations de l’autrice à sa mère là où, dans son récent „Irréfutable essai de successologie“, elle explique de façon on ne peut plus ironique comment au mieux se comporter pour, de nos jours, atteindre non pas à plus de bonheur et de bien-être, mais, comme ces influenceurs et influenceuses et autres écrivains de salon, dignes successeurs des pages mondaines d’un Marcel Proust, avoir plus de succès, de followers, de pages vues, imitant avec brio l’un de ces livres d’accomplissement personnel avec un cynisme dont on pourrait dire qu’il serait le signe d’une autrice devenue acariâtre et désespérée si ses analyses de l’autrice n’étaient pas aussi justes.
Ainsi, entre sa typologie d’hommes et de femmes à succès – l’influenceuse bookstagrameuse, l’homme influent, toute une ribambelle d’écrivains et de critiques littéraires –, ses conseils sur la conduite à tenir envers ces gens afin de s’orner soi-même des oripeaux du succès et ses astuces pour produire soi-même une œuvre littéraire à succès, l’autrice fait une sorte d’anti-portrait de tout ce que la littérature, la vraie, doit être: subversive, critique, rebelle, à rebrousse-poil et, dans le cas de Lydie Salvayre, décapante et drôle.
Car évidemment, pour avoir du succès, l’humour est jugé dangereux – „il a trop de chances d’être mal compris, d’offenser, de choquer, et il faudrait donc bien plutôt flatter le goût du bon nombre, lui servir bien rôties ses idées préconçues, les assaisonner d’une louche de bons sentiments, d’un peu de sel gaulois et de quelques olives, voilà qui fait sa félicité“.

Le diariste Eric Chevillard qui, au-delà de son travail de romancier et d’essayiste, publie depuis maintenant dix ans „L’autofictif“, un blog à trois entrées quotidiennes que les Editions de l’Arbre vengeur impriment une fois par an (le dernier en date s’appelle „L’autofictif selon Proust“) a, lui aussi, du mal à contenir sa mauvaise verve devant ces livres qui, faisant le succès des devantures de librairie, ne réussissent souvent qu’à heurter la littérature et la langue françaises à coups de publications ineptes, niaises et quelconques: après avoir relaté ses travaux peu fructueux sur Jaune soleil, un roman censé être un hymne à la vie, mais que les aléas personnels (fictionnels) transforment bien plutôt en catalogue d’infortunes, il note, le 1er septembre 2022: „Chaque année, en septembre, avec une régularité de métronome, je ne lis pas le nouveau roman d’Amélie Nothomb.“
Car la littérature drôle souffre de ces préjugés qui veulent que l’on associe l’humour à quelque chose de léger, là où la littérature, la vraie, celle que l’on trouve dans les manuels scolaires, se doit d’être profonde et lourde de sens (voire lourde tout court).
Pourtant, il y a beaucoup de façons d’être drôles – pour commencer, ne désigne-t-on pas un certain humour de lourd, qui commence par ailleurs de nos jours d’être de plus en plus souvent censuré, muselé, comme lorsqu’un humoriste allemand disait récemment qu’il avait fallu être bien naïf pour s’être imaginé que les afters du groupe Rammstein, dont le chanteur fait l’objet d’une enquête judiciaire à la suite d’accusations de viols de la part de certaines fans, se soient résumées à des séances où des gens se tenaient les mains en cercle fermé pour parler sentiments. Ainsi, comme l’exprimera l’un des personnages de „Toutes les personnes de Raphaël Meltz“, on peut distinguer entre les humoristes gentils et les méchants.
Déconstruire pour mieux recréer

Comme vous avez sans doute dû le deviner, et même si l’esquisse d’une telle typologie ne fera que nous rapprocher dangereusement de celle établie par l’autrice dans son „Irréfutable essai de successologie“, Lydie Salvayre appartient, tout comme Eric Chevillard, à ceux dont l’humour est grinçant – parce qu’il a pour objet de déconstruire le monde.
Mais c’est, on le verra, un peu réducteur, car chez Chevillard notamment, l’humour sert aussi bien souvent à une recréation poétique du réel, qui est à même de e sortir de sa monotonie, de cet habitus qui nous fait souvent utiliser des mots sans que l’on en analyse les potentialités et rimes cachées, insoupçonnées – puisque ce qui grince, dans le réel, c’est bien moins l’humour qu’un monde redondant que l’humoriste cherche donc à sortir de ses gonds.
Même Thomas Pynchon, père du postmodernisme américain, figure tutélaire qui a marqué la littérature mondiale et la culture pop au point que le site web de Radiohead est un hommage au grand inconnu de la littérature américaine, n’a jamais eu le prix Nobel, pour lequel il fut pourtant longtemps pressenti. L’obscurité et la complexité littéraire n’ayant jamais empêché un auteur de se voir décerner le prix par l’Académie suédoise, on peut supposer que lui aussi aura péché par excès de drôlerie.
Tout cela est d’autant plus injuste que l’on sous-estime la fonction esthétique, critique et philosophique de l’humour. Fonction esthétique, puisque l’humour permet de transformer, parfois en un tour de phrase, quelque chose de triste, voire de laid, en éclat de rire étincelant.
Fonction critique ensuite, puisque se moquer de quelque chose est souvent accompagné d’un moment analytique, qui peut même se transformer, en un deuxième temps, en pensée utopique, suggérant qu’il faudrait transformer le système tel qu’il est – et souvent, l’humour commence par la modifier, la réalité, en jouant sur ou en transformant les mots qui le désignent, le réel.
Fonction philosophique, enfin, puisque l’humour est un mode de vie, une carapace contre les aléas du destin qui sous-entend, en fin de compte, une vision tragique du réel, une conscience aiguë de notre mortalité que l’on entend ainsi combattre en ne prenant pas trop au sérieux les sales coups que la vie ne manquera pas de nous asséner.
Dans le meilleur des cas, cette heureuse collusion de l’humour avec l’esthétique, la charge sociétale et la philosophie donne lieu à des entrées comme celle du 2 janvier 2022 dans le blog chevillardien: „On ne s’embête pas dans cette résidence pour personnes âgées! La programmation des animations de la journée est affichée à l’entrée du foyer. 15h: belote. 16h: rebelote.“
Ennui et solitude des personnes âgées dans ces institutions où les familles les parquent souvent afin qu’ils ne fassent plus chier, manque de créativité d’un personnel qui souvent infantilise ses patients, mélancolie de ces institutions où la société fait disparaître ses vieux pour vivre dans l’ignorance de sa mortalité: dans cette microfiction d’Eric Chevillard, il y a plus d’analyse que dans certains romans dévoués au sujet.
Ainsi, un livre drôle peut tout autant inciter à la remise en question du monde, à une vision critique de la société qu’un livre triste, mélancolique ou à la tonalité sobre. Un livre drôle peut même être infiniment triste – au contraire d’un livre triste qui, lui, ne sera jamais drôle.
Drôlerie et noirceur, les deux faces d’une médaille

„Toutes les personnes“ de Raphaël Meltz n’est pas un livre drôle – mais c’est un livre profondément triste sur l’humour, qui commence par un entretien que donne Max, un humoriste, à Marcia, la chercheuse la française la plus en vue sur l’humour, qui passe donc sa vie à voir des spectacles drôles, à en rire puis à les décortiquer, à typologiser, à catégoriser et théoriser avec sérieux sur l’humour, à vouloir dépasser les textes séminaux de Foucault ou Bergson, mais aussi, de façon plus modeste, à passer des entretiens avec des spécimens qui pratiquent son sujet d’études.
Pourquoi est-ce que, quand quelqu’un est tellement drôle, c’est qu’au fond, tout est si noir en lui?
Cette interview avec Max marquera le début d’une relation dont les prémisses sont d’autant plus particulières que non seulement il y a conflit déontologique à coucher ainsi avec son sujet d’études, mais que Max, de surcroît, est un énorme fan de Michel Le Fou, humoriste légendaire et ancien partenaire de Marcia, qui s’est suicidé au bout de longues années de dépression, poussant Marcia et Max à se poser la question qui est au centre de ce beau roman touchant, qui parle autant d’humour que de relations humaines et de dépression: „Pourquoi est-ce que, quand quelqu’un est tellement drôle, c’est qu’au fond, tout est si noir en lui?“
C’était déjà une question au centre de „Melinda and Melinda“ de Woody Allen, qui racontait une seule et même histoire sous le prisme de l’humour puis de la tragédie et qui concluait que c’étaient souvent les humoristes dont la vision du monde était la plus pessimiste ou/et la plus tragique. Et l’on peut penser évidemment à David Foster Wallace, qui pouvait écrire les textes les plus drôles qui soient, et qui s’est donné la mort en 2008, à l’âge de 46 ans, au bout d’une existence minée presque incessamment par la dépression.
S’il y a dans le livre de Meltz des réflexions séminales sur le besoin d’avoir de la place pour de la méchanceté en nos démocraties occidentales – car, comme le dit Max, s’il aimerait bien qu’on soit tous gentils, la vérité humaine est ailleurs et il faut bien, quitte à être „le bouc émissaire de [s]on époque“, à tendre un miroir au peuple qui „dans son espace démocratique n’a pas d’opposant en tant que tel“ –, „Toutes les personnes“ est avant tout une belle réflexion sur le rire et le tragique, qui présente précisément l’humour comme une arme souvent imparable contre la tristesse et la dépression, quand il n’est pas, hélas, une manière de transcender nos gouffres personnels, nous permettant de sauver autrui par le rire quand nous n’en sommes plus capables nous-mêmes.
En témoigne cette scène où Michel, au bout d’une tentative de suicide ratée, raconte que son voisin de chambre avait essayé de se tuer en buvant une bouteille de Destop, inventant sur-le-champ, afin de faire rire Marcia, une typologie des tentatives de suicide dignes et indignes, le Destop se situant bien évidemment à l’extrémité no-go du spectre.
Que l’auteur présente de surcroît son court roman poignant dans un dispositif formellement ingénieux, quoiqu’un peu forcé sur sa fin, est un agrément stylistique non négligeable: lors de ses six chapitres, Meltz décline les six pronoms personnels comme autant d’instances narratives, la perspective de Max étant racontée en régime homodiégétique, celle de Marcia à la deuxième personne du singulier et ainsi de suite, jusqu’à un final un peu conciliateur écrit à la troisième personne du pluriel.
Mes proches et autres ennemis
Autre maître incontesté de la méchanceté, Eric Chevillard retourne, en cette année 2023, avec pas moins de trois parutions: à côté de „La Chambre à brouillard“, premier roman depuis son dernier „Monotobio“, où l’écriture de l’intime, jadis parodiée avec son „Du hérisson“, fut pratiquée de manière moins ostentatoirement moqueuse – ce fut peut-être le roman le plus intime et, du coup, aussi l’un des moins drôles de l’auteur –, Chevillard vient de faire paraître un essai sur le vertige („Craintif des falaises“) ainsi que le susmentionné „L’autofictif selon Proust“.
Si donc „Monotobio“ s’inscrivait dans le pastiche de l’autofiction, „La Chambre à brouillard“ commence, lui, avec une de ces parodies de roman noir qui parsèment l’œuvre de l’auteur, puisqu’il y relate la rencontre du narrateur avec un dénommé Oleg avant que celui-ci ne devienne l’un des maîtres incontestés des milieux criminels français, à une époque où les deux jeunes larrons se contentaient de plus innocentes simagrées, comme celle qui consistait à dépouiller de leurs biens de vieilles dames sans défense. Si le narrateur admet que ça ne fut pas là bien glorieux, il prétend qu’il fallait le comprendre, qui avait alors grandement besoin d’argent: „Mes parents, rats cupides, ne se saignaient que pour mes études, mon loyer et mes dépenses courantes. Ils ne me donnaient rien pour vivre.“
Après un court parcours biographique de cet ami de jeunesse, qui profita de la prison pour „reprendre ses études et combler ses lacunes“, se perfectionnant d’abord et „si bien en effet dans l’art du saucissonnage que, trois mois seulement après son incarcération, il ligotait deux gardiens avec les lambeaux de ses draps“, l’on comprend que notre homme a besoin des services d’Oleg pour retrouver son objet d’étude, un objet d’étude aussi indéfinissable que le fut l’animal Palafox dans son roman éponyme, et aussi potentiellement révolutionnaire pour la marche du monde que l’eût été Dino Egger dans cet autre roman éponyme où le narrateur Albert Moindre explorait tous les mondes possibles dans lesquels le génie aussi grand qu’inexistant que (ne) fut (pas) Dino Egger aurait réinventé non seulement la roue, mais aussi le monde et l’histoire de l’humanité – si seulement on l’avait donc fait naître, Dino Egger.
Un jour donc, on lui confie un objet mystérieux, qu’il croit être passé par les mains perverses son rival Gorius, cet objet d’étude, dont l’indétermination et la polyphonie en font évidemment une belle métaphore du langage que travaille l’auteur, ou encore une belle synecdoque des mondes imaginaires de la fiction littéraire, que l’on peut peupler à son gré des créatures de notre imagination, Chevillard reprenant ici quelque peu la liberté de sauter du coq à l’âne tel qu’on l’avait vu faire avec sa créature textuelle polymorphe de „Palafox“ en y glissant d’autres éléments désormais cultes de son univers.
On y voit donc réapparaître la haine du gratin de chou-fleur, l’amour pour la truite aux amendes („L’auteur et moi“) ou encore la dispute, très drôle, entre chercheurs ou écrivains („Démolir Nisard“, „L’œuvre posthume de Thomas Pilaster“) tout comme on y retrouve avec délectation l’un de ces narrateurs qui s’enfoncent dans leurs obsessions et finissent par s’aliéner leur entourage, leurs partenaires et famille au premier chef, qui finissent par se lasser encore de la mauvaise foi qu’ils ne manquent pas d’afficher: „Je danse plus souvent avec l’ours qu’avec toi, je dîne plus souvent avec le yéti“, se plaint sa conjointe Nine, alors que lui explique qu’il a fini par „renoncer à toute vie sociale, hormis les strictes obligations que je bornerai aux obsèques de mes proches et autres ennemis et aux cérémonies d’hommages (célébrations, remises de prix, décorations ou diplômes de docteur honoris causa qui viendraient récompenser mes travaux) auxquelles hélas il est impossible de se soustraire sans vexer la terre entière.“
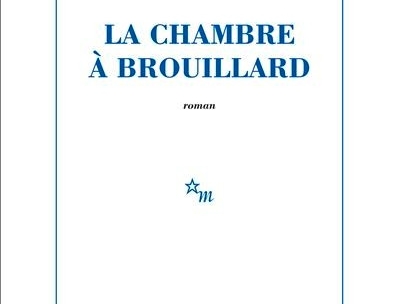
De la haute magie des calembours
Dans „La Chambre à brouillard“, Chevillard réussit donc une énième fois cet exploit dont on aurait pu penser qu’il nous lasserait un jour et dont Gustave Flaubert, lui, rêvait, qui apparaîtra par ailleurs en début de son „Craintif des falaises“, à savoir du livre sur rien, ou presque rien, du livre sur un sujet qui se dérobe et qui se cherche, du livre impossible à résumer tant on a peur de passer, comme le narrateur, à côté de son sujet ou de trop en dire – car il faut le découvrir (pour ceux qui ne le connaissent pas) ou le redécouvrir (pour ceux qui en raffolent déjà comme son narrateur raffole de la truite aux amandes).
De plus en plus économe dans son art du récit, abandonnant presque intégralement les périodes qui faisaient tout son art dans des romans comme „Dino Egger“ ou „L’auteur et moi“, l’écriture de Chevillard devient de plus en plus précise, presque aphoristique, sans que son art du récit ou ses calembours poétiques en pâtissent. Au contraire, depuis „Monotobio“, l’on peut croire que l’art de faire court auquel il s’adonne tous les jours sur son blog lui ait donné le goût des phrases aussi percutantes que ciselées, avec pour résultat un roman ou chaque alinéa ou presque est un petit joyau d’humour et d’intelligence.
Ainsi, quand il s’imagine sa conjointe le tromper avec son sujet d’étude et observer leurs câlins, leurs étreintes, leurs luttes puis leur agonie: „J’aime le spectacle vivant mais il faut un terme à toute chose.“ Ou encore quand il évoque l’apparition bien tardive d’un fâcheux personnage secondaire, dont on se rend compte bien vite qu’il n’est autre que le fils du narrateur: „Enfant déjà, il m’avait un jour surpris dans mon laboratoire comme j’étudiais les effets du cinéma pornographique sur le fonctionnement de l’appareil génital des quadragénaires bruns et très légèrement ventrus de l’hémisphère occidental à l’aube du XXIe siècle en me prenant bravement comme cobaye afin que nul innocent ne pâtisse de ces redoutables expérimentations si elles venaient à tourner mal.“
Bref, plutôt que de continuer à égrener ici une liste de citations propres à vous convaincre que la littérature drôle peut à la fois saccager le monde tout en le recréant à travers ce que Pynchon appelait la „high magic of low puns“, je vous conseille de les découvrir, ces auteurs, dont la noirceur a au moins le mérite d’être drôlissime et réjouissante alors que celle du monde, elle, n’est que déprimante.
Infos
– Eric Chevillard, „La Chambre à brouillard“, 2023, Les Editions de Minuit, 208 pages, 18 euros
– Eric Chevillard, „L’Autofictif selon Proust“, 2023, Editions de l’Arbre vengeur, 244 pages, 16 euros
– Raphaël Meltz, „Toutes les personnes“, 2023, Editions Stock, 158 pages, 18,50 euros
– Lydie Salvayre, „Irréfutable essai de successologie“, 2023, Editions du Seuil, 176 pages, 17,50 euros










Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können