Pig Brain
Ça commence avec un immeuble en feu, qui arbitrait un bar à hôtesses. Bien vite, les ragots circulent. Un professeur d’école primaire, monsieur Hori (Eita Nagayama) aurait été vu en sortir avec une demoiselle aux mœurs qui n’auraient déplu à Jeanne du Barry. Ç’aurait pu n’être qu’une anecdote un peu sulfureuse, si Hori n’était pas l’enseignant de Minato (Soya Kurokawa) – et qu’à l’école, les incidents autour du jeune enfant se multiplient: à sa mère Saori (Sakura Ando), le jeune enfant confie son inquiétude qu’on ait remplacé son cerveau par celui d’un porc, idée absurde dont on en vient rapidement à penser que c’est Hori qui la lui a mise en tête, qui lui aurait aussi tiré l’oreille jusqu’à ce qu’il saigne.
Convoqué par une directrice d’autant plus absente qu’elle viendrait d’enterrer sa petite-fille, qui confirme à une Saori offusquée qu’il y aurait bien eu un „contact entre la main du professeur et le nez de son fils“, l’instit doit s’excuser auprès de la mère célibataire, dont le personnel enseignant rationalise les emportements par le fait qu’elle soit veuve et doive élever seule un fils au comportement étrange.
Be Kind Rewind
Alors que les indices s’accumulent et que l’on se doute qu’il y a quelque chose qui cloche, qui tourne notamment autour de cette cervelle porcine par laquelle un parent essaie de convaincre son enfant de la monstruosité de son désir homosexuel, le film s’arrête net et reprend du début, cette fois à travers la perspective de Hiro qui, longeant l’immeuble en feu avec sa partenaire (et non pas, comme les rumeurs le voulaient, au bras d’une hôtesse, corrige-t-on mentalement), observe son évacuation.
Et le spectateur de comprendre que cet incendie métonymique est aussi un moteur narratif, le moment où s’achoppe le rembobinage et où l’intrigue est relancée, et que chaque nouveau parcours à travers le dédale de ce film-puzzle permettra de reconfigurer les faits observés, de leur donner une interprétation nouvelle, quitte à devoir abandonner une première lecture, où on réceptionne le film comme un thriller sur la maltraitance enfantine, pour une autre, qui parle d’amour et de désir non assumé, ce film-oignon obligeant son public à collectionner les indices afin de reconstituer, à travers le tissu de ragots, de demi-vérités, d’images décontextualisées, non seulement ce qui a eu lieu, mais aussi et surtout, de quoi il parle vraiment.
Etymologiquement, monstre vient du latin monstrare – ce qu’on montre, qu’on désigne, qu’on pointe du doigt. Et pointer du doigt, tous ou presque le feront, dans cette huitième contribution cannoise du réalisateur de „Shoplifters“, qui raconte sous trois angles différents non pas une même histoire, mais une même chronologie, dont ressortent trois récits on ne peut plus différents.
Car si Kore-Eda recourt à une forme narrative typiquement moderniste – comme chez William Faulkner, différents points de vue permettent de voir la subjectivité de toute reconstruction du réel –, ça n’est plus pour montrer le décalage entre différentes visions du réel, mais bien pour montrer que, dans le monde qui est le nôtre, les cloisonnements sont tels que chaque récit donne naissance à une ontologie propre, de sorte que Kore-Eda ne montre pas trois interprétations du réel, mais bien trois mondes distincts qui s’entrechoquent et que l’empathie du professeur parvient à relier: du premier chapitre, sombre, où une mère s’interroge de plus en plus, sans vouloir se l’admettre, sur la monstruosité éventuelle de son propre rejeton, dont il est suggéré qu’il pourrait jouer une part active dans le harcèlement d’un camarade de classe, à la fin lumineuse, sorte de relecture inversée de „Close“, où les enfants vont de la honte au bonheur assumé, il y a une distance infranchissable, que le film traduit par des choix esthétiques différents, tant au niveau des couleurs que celui du ton narratif.
Si Kore-Eda paraît parfois être quelque peu trop fier de son échafaudage narratif, où toutes les pièces du puzzle (ou presque) finissent par trouver leur place, étouffant un peu trop le mystère qui planait au long de la première partie, qui suggérait à quel point l’autre est toujours méconnaissable, si „Monster“ est donc pendant longtemps un peu trop amoureux de son propre formalisme, de sorte que les émotions, quand elles affluent vers la fin, manquent parfois de vraisemblance, si l’on peut encore se demander si le réalisateur n’accumule pas toutes ces couches narratives parce qu’il ne sait pas comment aborder le désir homosexuel de deux enfants, il n’en reste pas moins que le nouveau Kore-Eda, qui ouvrait la compétition mercredi, est un portrait touchant, humaniste, qui montre à quel point les ragots et médisances des adultes constituent un terrain fertile pour la cruauté des enfants, cruauté dont deux enfants, par amour et à travers le jeu, parviennent à s’émanciper.
C’est ce que montre la scène la plus émouvante du film: après avoir entendu des cuivres dissonants dont on pensait d’abord, lors du premier parcours narratif, qu’il s’agissait d’un effet sonore extradiégétique illustrant une scène-clé, l’on apprend que ce sont en réalité le jeune Mugino et la directrice qui jouent ensemble afin d’exprimer tout ce qu’ils n’arrivent pas à dire par des mots – car, comme l’exprime cette femme réservée, terrassée elle-même par la mauvaise conscience, le bonheur n’est pas réservé à quelques rares élus, il est à disposition de qui ose en vouloir, peu importe que la société accepte et rejette qui vous êtes. Chez Kore-Eda, le vrai monstre, c’est ce Léviathan sans cesse recomposé qu’est le regard moqueur des autres.
Ça se corse: „Le retour“ de Catherine Corsini

Précédé de diverses polémiques dévoilées par une enquête de Libé, qui relatait notamment des accusations de harcèlement sexuel sur une mineure, des violences verbales ainsi que des comportements humiliants de la réalisatrice envers sa première assistante, toutes choses qui suspendirent pendant un moment la sélection cannoise du film, le nouveau long-métrage sur Catherine Corsini aura déjà fait couler beaucoup d’encre sans même que l’on ne soit beaucoup intéressé à son contenu.
C’est pourtant rendre peu de justice au long-métrage lui-même, qui voit Corsini, revenir sur la Croisette avec un long-métrage plus intime, à première vue moins politique que „La fracture“, en compétition à Cannes il y a trois ans, qui se focalisait autour du service urgences d’un hôpital pris d’assaut par des rescapés d’une manif Gilets jaunes brisée par des CRS violents (notez le pléonasme) et où se virent réunis tout un échantillonnage d’une société clivée par des décisions politiques cruelles. „Le retour“ raconte, comme son titre l’indique fort simplement, le retour en Corse d’une mère et de ses deux filles, quinze ans après qu’elles en furent parties en deuil, le père ayant dépéri dans un accident de voiture.
Pour légitimer le retour sur l’île, il fallait bien un prétexte narratif, assez gros pour que Corsini n’insiste pas trop là-dessus, ce qui lui fera par contre négliger quelque peu le personnage de la mère, comme si la timidité du personnage interdisait à sa caméra de trop s’approcher d’elle: si Khedidja (interprétée par Aïssatou Diallo Sagna, qu’on avait découvert dans „La fracture“) retourne sur le lieu qu’elle a fui il y a quinze ans, c’est que son poste d’assistante maternelle l’amène à venir s’y occuper des enfants d’un riche couple de Parisiens (Virginie Ledoyen et Denis Podalydès en bourgeois délicieusement insupportables).
Ça sera l’occasion pour Corsini de filmer un coming of age somme toute assez classique, qui conduira Jessica (Suzy Bemba) et Farah (Esther Gohourou), les deux sœurs dépareillées sur lesquelles le film se focalise, à cumuler diverses expériences, à se chamailler puis se rabibocher: si Jessica, l’aînée favorite qui compte faire Sciences-Po, s’émancipera de son image de fille modèle en s’amourachant de la fille du couple parisien, en prenant trop de drogue lors d’une soirée de fête et en partant sur les traces d’un secret familial dont elle ne soupçonnait pas même l’existence, Farah, elle, voudra mettre ses pas dans ceux de son père décédé, dont l’absence totale de souvenirs l’enjoindra à fréquenter le meilleur ami du paternel, qui lui racontera un passé de jeunes fouteurs de merde qu’elle se mettra à imiter, revendant de la beuh volée sur un jeune surfeur raciste qu’elle finira par fréquenter après qu’une tentative de délester des touristes de leurs portefeuilles eut tourné au vinaigre.
Certes, l’on pourrait reprocher à Corsini d’avoir mis quelque peu en sourdine son mordant en reléguant des problématiques sociétales en arrière-fond: le racisme des habitants corses est un peu traité à la va-vite, et on aurait aimé plus de moments forts comme celui où Farah, lavant les vêtements de sa sœur aînée, reproche à sa mère de l’avoir affublée d’un prénom étranger là où celui de sa sœur lui aurait permis de se fondre dans le décor, posant les jalons d’une carrière scolaire brillante – et la malicieuse Farah, dont l’emportement était au départ une façon de se dédouaner de ses propres échecs scolaires, de remarquer qu’elle vient, presque malgré elle, de trouver, au fond de sa révolte d’ado, la laide face du racisme structurel.
„Le retour“ n’en fonctionne pas moins, grâce notamment au jeu de ses actrices, subtil et crédible, grâce aussi à une caméra qui leur colle à la peau, les filmant de façon sensuelle et sensible dans leur intimité de jeunes adultes tantôt fragiles et tantôt déterminées, Corsini réussissant des passages-types du coming of age avec assez de subtilité et d’empathie pour en faire ressortir de l’émotion, voire de l’humour – l’essence de ce film, on la sent lors d’une soirée de teuf où les sœurs, séparées par une dispute, se retrouveront sur fond de drogue, salle de bain ravagée et premier baiser de la cadette ou encore quand l’aînée, retournant au village natal du père et y découvrant une grand-mère dont on lui avait tu jusqu’à l’existence, se sent d’abord attirée puis repoussée par cette femme qui les trouve „trop grandes“, elle et son amante, pour encore dormir ensemble. Si „Le retour“ n’est pas une grande fresque politique, c’est un beau portrait d’une famille qui, lentement, se remet d’un deuil.
La route du bonheur: „Jeunesse“ de Wang Bing

Il fut éprouvant, ce deuxième jour de compétition, pour ceux et celles en tout cas qui firent précéder la projection de „Jeunesse“ par celle de „Occupied City“ de Steve McQueen, cet autre documentaire à rallonge tant attendu où le réalisateur de „Shame“ juxtapose le quotidien pandémique d’Amsterdam à des récits de déportations de la population juive du temps de l’occupation nazie dans un portrait géopolitique qui cherche à faire exister à nouveau, par la voix narrative, un passé enfoui, transformant Amsterdam en véritable ville-palimpseste.
Pour ce qui est de „Youth“, difficile de ne pas penser à „Hard Times“ et comment le travail à la chaîne fut, grâce à Chaplin, l’un des tout premiers mythes du cinéma, dont les grandes productions furent par la suite bien plus enclines à s’intéresser aux destins extraordinaires, décorant leurs films de ces mêmes intérieurs fastueux que purent s’offrir les plus clinquants des stars hollywoodiennes, laissant l’exploitation des destins ouvriers au cinéma d’auteur, où le sort des démunis reste cependant bien souvent enchâssé dans un récit bien ficelé, épargnant au public souvent issu d’une classe sociale supérieure l’éprouvante monotonie de leur quotidien.
Pas de ça chez Wang Bing, qui revient à Cannes avec un documentaire en compétition, fait rare qui semble répondre à la présence de „Sur l’adamant“ de Nicolas Philibert en compétition à la Berlinale, couronné par l’Ours d’or. Totalisant pas moins de 212 minutes, „Youth“, coproduit par la société luxembourgeoise Les Films Fauves, est aussi le film le plus long de la compétition, talonné de près par „Les herbes sèches“ du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan.
Que ceux ou celles qui trouveraient un peu trop compactes encore ces quelque trois heures et demie de la part d’un réalisateur qui avait fait parler de lui avec „A l’ouest des rails“, un documentaire de neuf heures sur un complexe industriel chinois, soient pourtant rassurés: le „Youth“ projeté à Cannes n’est qu’un extrait d’une œuvre qui avoisinera les neuf heures, pendant lesquelles Wang Bing nous amène dans des sweatshops chinois de la province de Shanghai, à Zhili, pour être plus précis, où il nous montre donc, d’un regard implacable, immersif, le quotidien de (très) jeunes ouvriers et ouvrières venus de la campagne dans l’espoir d’amasser un petit pactole qui leur permettra de se lancer ensuite dans la vraie vie, et qui se rendront vite compte que la vraie vie, dans un monde globalisé et donc globalement soumis aux aléas de la productivité (qui équivaut, dans le domaine qui nous occupe, donc celui les textiles, à tant de pièces ou ballots par heure), ça risque de se limiter à ces ateliers où ils s’acharnent et s’épuisent.
„Pas de sueur, pas de fric“
Muni d’une caméra qui est aussi omniprésente qu’effacée, qui ne suscitera qu’en de rares occasions un commentaire de ceux et celles qu’il filme, comme quand un jeune ouvrier lui dira que ça vaut le coup de filmer ce qui va suivre, car „c’est ça la vraie vie“, Wang Bing montre la monotonie d’un travail qui s’accomplit dans d’innombrables petits ateliers où la négociation du salaire se fait, yeux dans les yeux, avec le manager et son épouse, qui bien que mettant eux aussi la main à la pâte, n’en sont pas pour autant plus cléments avec leurs salariés puisque engagés dans des contrats et des commandes, pour lesquels il y a des pensums à remplir et qui les obligerait à des calculs d’épicier où des sommes dérisoires se négocient aussi âprement qu’inlassablement.
Véritable document-fleuve qui nous épargne donc toute structure narrative à même de forcer une empathie qui ne durerait que le temps d’un récit bien orchestré, on plonge dans l’enfer ô combien bruyant de ce monde de la confection textile, où l’on voit des jeunes reproduire à une vitesse hallucinante des gestes de machines et qui se draguent, souvent maladroitement, se bousculent, se chamaillent, vont parfois jusqu’à la bagarre, se blessent – verbalement, mais aussi physiquement –, sont connectés sur le monde pseudo-utopique de leur smartphone, négocient des jours de congé, tombent enceintes et avortent – et cela aussi prête à discussion avec le patron –, se taquinent, bref négocient non seulement leurs salaires mais aussi la part de vie et de bonheur, menue, qui peut leur rester et qu’ils revendiquent sans cesse.
Wang Bing montre sans complaisance la promiscuité des dortoirs, les immeubles crades où les ouvriers s’entassent, le pauvre contingent de vie qui leur reste et qu’ils comptent bien s’approprier. Si la redondance du documentaire, qui ressasse encore et encore les avances maladroites de jeunes hommes qui se font recaler par de jeunes ouvrières malicieuses et qui s’épuise à montrer de longues négociations pour quelques yuans de plus sous l’œil impavide et indifférent des maneki-neko a parfois quelque chose d’hypnotisant et s’il était important, pour nous qui sommes déjà épuisés à endurer ce bruit et cette monotonie pendant ne serait-ce que quelques minutes, de nous la faire éprouver, cette bruissante redondance, force est d’admettre que la longueur du film peut paraître excessive au vu du fait que „Youth“ a, au bout de deux heures, décliné tout ce qu’il avait à dire sur un plan politique, humain et émotionnel.
„Youth is wasted on the young (workers)“, pourrait-on paraphraser Georges Bernard Shaw – et s’il paraît d’abord ironique qu’un des ateliers soit installé sur Happiness Road, Wang Bing prend ce hasard très au sérieux – loin de tout misérabilisme, ces jeunes ouvriers se révoltent en essayant d’être heureux. C’est, peut-être, la meilleure rébellion qui soit.
Quinzaine des cinéastes: Trois voyages dans l’intimité de ceux à qui on ne pense pas
Pauline Cano
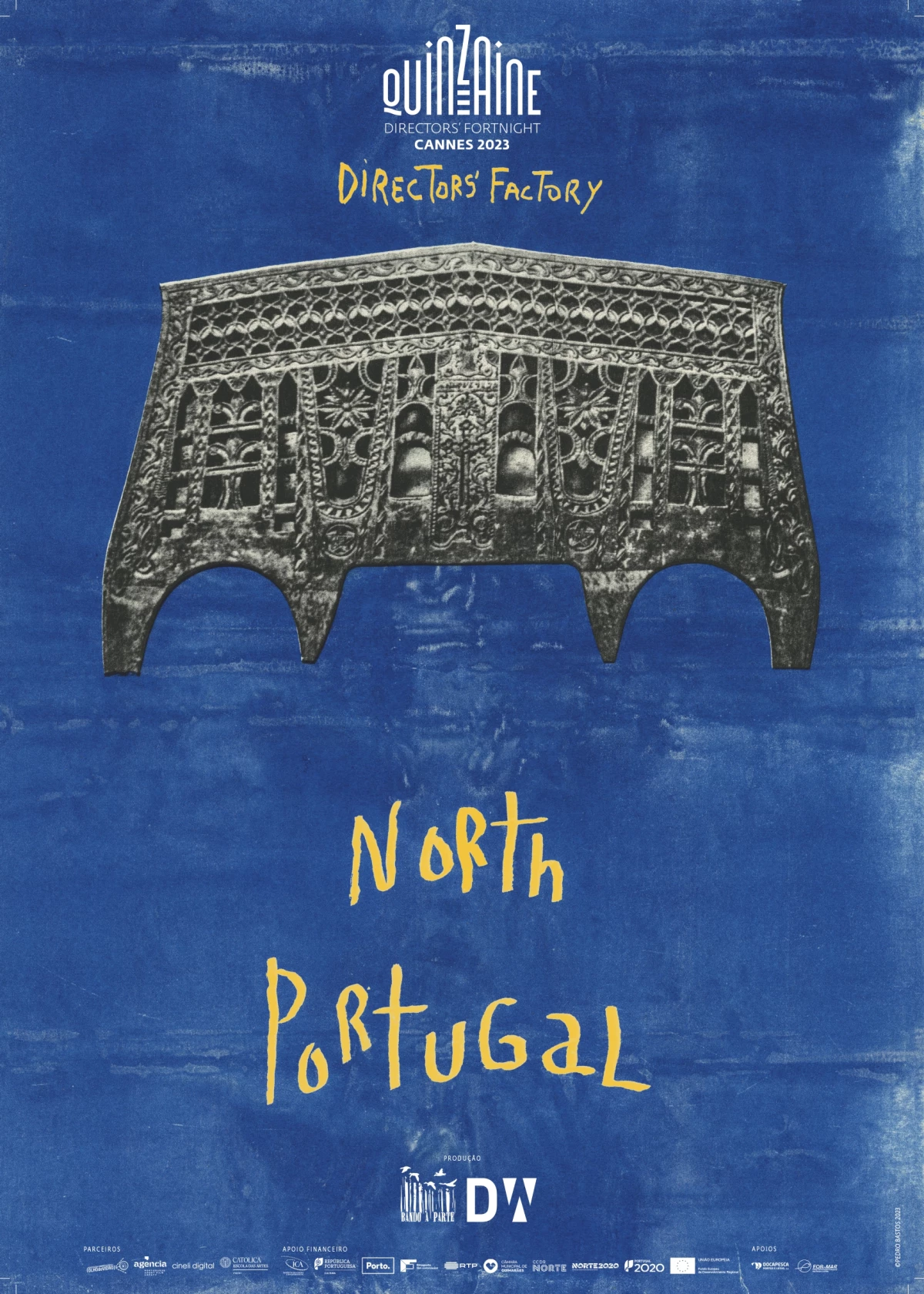
Les thématiques des trois court-métrages réalisés dans le cadre de l’édition 2023 de la Factory des Cinéastes, dirigée par Dominique Welinski, se rejoignent toutes sur un point – l’étouffement dans les normes imposées par la société.
La Factory des Cinéastes est un programme destiné à donner une voix à des cinéastes en devenir en leur faisant co-réaliser un court-métrage avec un cinéaste qu’ils ne connaissent pas. Cette année, trois binômes homme-femme ont été créés, associant trois cinéastes du Portugal du Nord à trois cinéastes internationaux.
Les trois œuvres présentées furent „Espinho“ („L’Écharde“), réalisé par André Guiomar (Portugal) et Mya Kaplan (Israël), „Maria“ par Mario Macedo (Portugal) et Dornaz Hajiha (Iran) et „As Gaivotas cortam o ceu“ („Les mouettes dévorent le ciel“) par Mariana Bártolo (Portugal) et Guillermo García López (Espagne).
La domination de l’Eglise est un sujet sur lequel se concentrent les deux premiers court-métrages. Dans „Espinho“, le personnage du prêtre semble être la figure de proue des villageois aveuglés par la foi, alors qu’il peine à cacher, voire même à refouler son intérêt singulier envers Téo, un adolescent renfermé.
En ce qui concerne „Maria“, la religion serait plutôt un refuge face à une famille patriarcale au bord de l’éclatement où Maria, le personnage principal, doit gérer la rébellion des jeunes et l’autorité des hommes sous un même toit.
Le court-métrage du couple hispano-portugais s’éloigne de la thématique de la religion pour aborder un autre sujet, traité moins souvent – celui de l’amour entre deux femmes de plus de quarante ans. En effet, lorsqu’il s’agit d’homosexualité dans un film, la plupart du temps, elle est racontée à travers la perspective d’adolescents ou de jeunes adultes.
Les dialogues des trois courts-métrages ne sont composés que des banalités du quotidien, ce qui fait parler les images d’elles-mêmes et nous ouvre les portes de l’intimité de personnes qui ne trouvent pas leur place dans les normes imposées.

 Zu Demaart
Zu Demaart








Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können