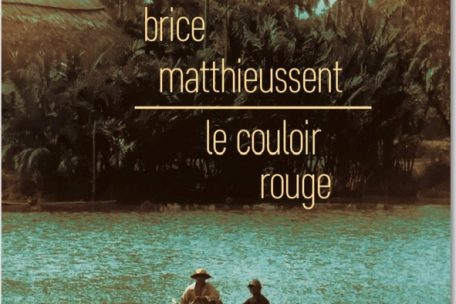
On connaît Brice Matthieussent comme l’un des plus prolifiques traducteurs de la littérature américaine contemporaine, qui a entrepris, aux côtés de Claro, cet autre écrivain traducteur chevronné et infatigable, le travail titanesque de traduire le complexe et épais „Mason & Dixon“ de Thomas Pynchon. On le connaît aussi pour „La Vengeance du traducteur“, un roman ludique, formellement novateur, où un traducteur, comme le nom de l’ouvrage l’indique fort bien, sabotait en notes de bas de page un hypotexte invisible.
Pour son huitième roman, paru non plus chez P.O.L. mais chez Christian Bourgois, Matthieussent ose un roman postcolonial en forme d’hommage à Joseph Conrad, qui interrogea la possibilité d’écrire sur le passé colonial de la France sans reproduire les clichés d’exotisme ni pratiquer une critique postcoloniale manichéenne, souvent trop surplombante pour véhiculer une impression de vécu intime et autocritique.
„Le couloir“ rouge s’ouvre sur un récit-cadre qui plonge d’emblée le lecteur et ses personnages dans une époque révolue: tous les premiers samedis du mois, quatre hommes qui estiment avoir, chacun à sa manière, „fait un pas de côté hors du rang des ,maîtres blancs‘“, se réunissent au Dalat, un vieux restaurant vietnamien où tout semble dater des années 1950 ou 60 et où tout porte les traces d’innombrables réparations, restau où ils ont accueillis par un propriétaire au nom involontairement ironique, Vuong signifiant „prospérité“ en vietnamien.
C’est lors d’une de ces réunions mensuelles que l’un deux, Marco, qui a beaucoup voyagé et publié des livres, prend la parole pour ne plus la lâcher, son récit-confession durant jusqu’à l’aube et même au-delà, qui relate comment son jeune alter ego, avide de voyage, d’expérience et de sensations, fatigué par le „matérialisme de l’Occident, sa croyance aveugle aux vertus du progrès“, fasciné par la drogue, le zen et le bouddhisme tibétain, cherchant donc à rompre avec un mode de vie sous l’égide du capital, se trouve embarqué pour un voyage de noces sans son épouse à Dalat en pleine guerre du Vietnam, grâce ou faute à une lettre écrite à André Malraux et à un général ronchon.
A Dalat, où il arrive après avoir passé une semaine à Saïgon, ville suffocante dont il finira, à cause du décalage horaire, de sa „solitude forcée“ et de l’impression, parfois, de „nager à travers l’air des rues“, par douter de la réalité, il déchante vite, non seulement à cause de la guerre, qui accompagnera ses péripéties comme un soubassement (pas si) lointain, mais surtout à cause de la vie des colons, qui se languissent dans une ville qui ne fait que reproduire l’architecture et les habitudes culinaires du pays natal, tout Dalat paraissant un „décor d’opérette destiné aux colons français en mal d’oxygène“: „dès les années 1900, les urbanistes nommés par les gouverneurs successifs [y] aménagèrent […] des rues arborées, des boulevards coquets, de larges avenues, tous bordés de villas normandes, de chalets savoyards, de maisons basques, de fermes bourguignonnes, en plus d’une hideuse cathédrale néogothique et d’une gare de chemins de fer qui, tenez-vous bien, était la réplique scrupuleusement exacte de la gare de Deauville.“
Au cœur du récit de Marco, qui relate d’abord l’ennui et la décadence de ses compatriotes vivant dans une bulle bien à eux, inconscients à la fois des forces armées qui progressent tout comme des répercussions de la guerre sur leur quotidien dans ce Disneyland de pacotille, se trouve une double perte du langage, la première inspirée par l’expérience de l’horreur absolue lors d’une visite à une connaissance hospitalisée à la suite d’une attaque au couteau par un Vietnamien, la deuxième, qui a plus à voir avec l’expérience de l’amour, surgissant au cours de la déroute quand, cherchant à retourner en France alors que le Sud est en train d’être conquis par les troupes communistes du Nord, il se retrouve aux côtés de Lucien, un déménageur français raciste et complètement taré. Peu à peu, il deviendra clair que Marco a porté en lui ce double indicible, ce reflux de la parole, au long de toutes ces années jusqu’à la libération de la parole, l’épiphanie nocturne en présence de ses amis que constitue ce récit.
„C’est l’heure d’aller guincher avec les sauvages“
Là où le ton d’Eric Vuillard, dans son magnifique „Une sortie honorable“, était grinçant, ironique, qui analysait, comme il l’avait fait avec brio dans „L’ordre du jour“, l’hypocrisie, les déficiences et la nullité des discours et choix politiques relatifs à la guerre en Indochine, Matthieussent propose une lecture plus intime, plus métaphorique, des déboires de la colonisation et de la guerre, en faisant une expérience presque métaphysique, qui interroge aussi la façon de dire l’horreur de la guerre et le „cloaque de l’esclavage“ sans tomber dans les clichés ou reproduire, à l’intérieur même de la dénonciation, des propos racistes.
C’est pour cela que la double expérience, face au thanatos et à l’éros, de „larguer les amarres du langage“ procure „un soulagement étrange“, le narrateur se retrouvant „face à la pureté acérée de l’expérience“. Et si le langage, ou le retour inévitable au langage, continue-t-il alors, n’était qu’une „malédiction, seulement apte à retourner le couteau dans la plaie? Proposerait-il au mieux une voie d’accès mélancolique à ce qui a définitivement disparu?“
Si le récit de Marco, ce traître qui choisit de passer une soirée loin des maîtres et possesseurs pour s’enfoncer, lors d’une longue scène sous emprise d’alcool de riz et de champignons hallucinogènes, dans le labyrinthe d’une maison commune d’esclaves travaillant sur une plantation de théiers pour Gérard et Hortense, deux horribles colons qui assument et pratiquent, comme Lucien, un racisme presque caricatural, elle cherchant à convertir au christianisme ses travailleurs, lui ayant tant pris goût à l’esclavagisme qu’il y a réduit sa propre mère, si le récit de Marco cherche à éviter le racisme et la domination des colons (à un moment, Lucien réveillera Marco en lui disant „c’est l’heure d’aller guincher avec les sauvages“), il n’en reste pas moins empreint d’une sorte de fascination pour l’autre qui le dépossède de ce qu’il est, cet autre.
Faisant cela, il ne réussit jamais à se dépêtrer de ce regard de l’extérieur, auquel il se sait condamné. Et si l’écriture de Matthieussent le rend bien, on aurait peut-être aimé que la tension du récit entre la soif d’aller hors de soi, hors du monde occidental et une appartenance impossible soit moins manichéenne, que le récit souligne encore davantage ce que cette tension même a d’intrinsèquement occidental.
Ecrit dans une langue riche, généreuse, précise, qui ose des périodes aux constructions alambiquées et de longues descriptions qui immergent le lecteur dans un décor pris entre exotisme et reconstruction incongrue de la Heimat française (la description de la maison de maître de l’imbuvable Gérard, avec ses tableaux pseudo-exotiques ou franchement racistes, est extraordinaire), une langue que d’aucuns jugeraient aussi surannée que la vision du monde de ces quatre amis ou que ce restaurant vietnamien qui survivote plus qu’autre chose mais qui en réalité se fait le reflet fidèle d’une époque, épousant la pensée de ses deux narrateurs, „Le couloir rouge“ réussit à nous donner l’impression, le temps de la lecture, de sortir, comme le dit Conrad, de cet „agencement de petites commodités“ par lequel nous rendons le réel vivable pour nous plonger dans le „vaste et lugubre chaos“ qu’est, en réalité, le monde.
Info
Brice Matthieussent, „Le couloir rouge“, 2022, Christian Bourgeois éditeur, 208 pages, 18 euros.
Lire plus loin: Eric Vuillard, „Une sortie honorable“, 2022, Actes Sud, 208 pages, 18,50 euros.

 Zu Demaart
Zu Demaart








Sie müssen angemeldet sein um kommentieren zu können